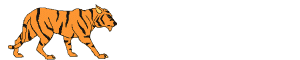Les naissances d’animaux rares dans les zoos : bonne ou mauvaise chose ?
« Nous avons une chance incroyable de vivre ici cette naissance ». Ce sont les mots émouvants de Sarah Lafaut, curatrice des mammifères au Zoo de Planckendael. Le parc animalier vient d’accueillir un rhinocéros unicorne indien, une espèce rare. Mais se pose désormais la question : Est-ce que les zoos en Belgique perpétuent la préservation d’une espèce protégée ?
Karamat et Gujurat sont heureux d’annoncer la naissance de leur troisième enfant (il n’a pas encore de nom). L’accouchement s’est très bien passé, le petit est né à 3h39 le 7 août 2025 et pèse 60 kg. L’acte de naissance est établi, une situation exceptionnelle pour le Zoo de Planckendael. En début d’année, Pairi Daiza a également annoncé la venue d’une autre espèce rare, un rhinocéros blanc.
Avec près de deux millions de visiteurs par an, les parcs animaliers belges sont une des attractions les plus prisées par les familles. S’approcher tout près des lions, donner à manger aux girafes, mais aussi apercevoir des animaux protégés et rares, une activité qui émerveille les petits comme les plus grands. C’est d’ailleurs une des missions des zoos ; garantir le bien-être animal et préserver les espèces les plus menacées (notamment du braconnage).
Créer une population réserve en cas de catastrophe
Avec la venue du nouveau rhinocéros unicorne indien, le zoo de Planckendael est fier de perdurer cette espèce qui fait partie du IUCN (Union internationale pour la conservation de la nature).
Cette organisation internationale établit une "liste rouge" avec l’inventaire mondial complet des espèces végétales et animales en risque d’extinction. "Il n'existe que 2800 rhinocéros unicornes dans le monde et principalement en Inde et au Népal" nous rapporte Ilse Segers, la porte-parole des zoos de Planckendael et d’Anvers, avant d’appuyer la mission des parcs animaliers en ce qui concerne les naissances des espèces sur la liste rouge.
"S’il y a un jour une tempête, une inondation ou une autre catastrophe, pour ces espèces c’est tout simplement fini pour elles. Avec des naissances dans les zoos, on créé une population réserve qui sera éventuellement prête à être remise dans la nature pour continuer le développement de cette espèce".
Un avis partagé par l’autre grand parc animalier du pays, Pairi Daiza. "Chaque naissance dans un parc animalier est bien plus qu’un heureux événement : c’est une étape essentielle d’un travail de conservation intégré, qui combine les actions menées dans les milieux naturels et celles conduites en parc zoologique pour assurer la survie à long terme des espèces. Ces naissances renforcent les populations ex situ, qui peuvent soutenir des programmes de réintroduction ou servir de réservoir génétique pour les espèces les plus menacées. Elles représentent par ailleurs un puissant levier de sensibilisation du public aux enjeux de la biodiversité mondiale", explique Catherine Vancsok, la directrice scientifique de la Fondation Pairi Daiza.
Ilse Seger, la porte-parole du parc de Planckendael ajoute encore que "pour les aider, les naissances dans les parcs ne sont pas suffisantes. Il faut aussi apporter une contribution dans leur milieu naturel".
Cet objectif est celui qui guide l’organisation internationale World Wide Fund for Nature (WWF) depuis 64 ans. "Nous voulons que les populations d’animaux sauvages à travers le monde puissent s’épanouir et que les humains puissent vivre en harmonie avec la nature, et nous travaillons chaque jour pour y parvenir. Dans certaines circonstances, nous considérons que les zoos accrédités par l’EAZA (L’Association européenne des zoos et qui a pour mission de promouvoir la coopération entre établissements zoologiques dans le but de préserver les espèces animales) peuvent jouer un rôle dans la conservation de certaines espèces sauvages. Mais la meilleure manière reste d’investir dans la conservation de ces espèces dans leur habitat sauvage, et notamment pour les rhinocéros, de lutter d’une part contre le braconnage et le trafic de leur corne, et d’autre part contre la disparition, la dégradation et la fragmentation de leur habitat naturel" explique Nicolas Tubbs, directeur des programmes internationaux du WWF-Belgique.
"C’est du greenwashing !"
Donner naissance à un animal en captivité n’est pourtant pas toujours une bonne chose pour une espèce. Certaines sont condamnées à vivre pour l’éternité dans des enclos.
"Quand ils sont relâchés, ce sont des bombes à contamination" – Johan Michaux
C’est ce que nous dit Johan Michaux, directeur de recherche au Fonds national de la recherche scientifique et professeur à l’Université de Liège, spécialisé dans les espèces en voie de disparition. "Par exemple pour ce jeune rhinocéros indien, c’est bien sympathique, mais ce qui est certain c’est que ce n’est pas cette naissance qui va sauver le rhinocéros indien. Tout simplement. Il faut savoir que souvent, les espèces qui sont nées en captivité auraient très peu de chance de survivre si elles étaient relâchées dans le milieu naturel. Ces animaux qui naissent en captivité sont condamnés tout simplement à vivre en captivité, à passer peut-être d’un zoo à l’autre, mais très rarement à être utilisés dans des programmes de réintroduction, sauf programmes tout à fait particuliers mais qui sont vraiment étudiés de manière très précise et qui sont très coûteux. Ça peut même être très dangereux en fait, de réintroduire des animaux à partir de zoos, parce que ces animaux peuvent être contaminés par des virus, par des bactéries qu’ils ont acquis en étant en contact avec d’autres espèces qui vivent aussi en captivité ou avec des humains. Ce sont des bombes à contamination".
Un autre problème des naissances en captivité est la consanguinité, rappelle Johan Michaux. "Même s’il y a des échanges entre les zoos pour éviter au maximum la consanguinité, malheureusement et très fréquemment, cette diversité génétique peut être faible. Ce qui donne des populations captives qui n’ont pas suffisamment de diversité pour pouvoir vivre dans le milieu naturel et s’adapter aux conditions naturelles. Je trouve un peu hypocrite en fait, le fait de dire "regardez, on va garder toutes ces petites bestioles dans les zoos pour les remettre dans leur milieu naturel après. À part quelques cas exceptionnels, ces animaux sont condamnés à vivre en captivité toute leur vie…"
Pour expliquer son point de vue, le directeur de recherche prend un exemple sur lequel il a travaillé ; celui des chimpanzés du Zoo de Beauval en France. "Ils ont réintroduit en Afrique des chimpanzés. Mais ces chimpanzés n’ont pas été remis dans la forêt profonde. Ils ont juste été mis sur une petite île avec d’autres chimpanzés qui venaient aussi d’autres zoos ou capturés à la douane. Mais ce ne sont pas des chimpanzés qui ont retrouvé vraiment une vie naturelle, parce que justement, ils sont imprégnés et ils n’ont plus du tout le même comportement sauvage qu’on retrouverait dans les vraies populations. Au lieu d’être emprisonnés dans des enclos, ils sont simplement prisonniers sur un autre îlot".
Remettre une espèce dans son milieu naturel ? Un processus très long et très précis
Si, selon Johan Michaux, remettre une espèce dans son habitat naturel est presque utopique, il existe quand même des possibilités. "C’est très très très compliqué. Il existe des guidelines (directives), déterminées par l’Union internationale pour la conservation de la nature. Tous ces projets se basent d’abord sur des études en amont avant de faire la réintroduction. Donc, on va essayer de comprendre s’il y a suffisamment de diversité génétique ? Est-ce que les animaux ne sont pas touchés par un virus qui pourrait contaminer les autres dans la nature ? Est-ce que ces animaux ont un comportement qui leur permettra de survivre dans la nature ? Et ainsi de suite. Si ces études s’avèrent positives et faisables, on envisage de réintroduire les animaux. Et là, en fait, pendant de longues années, on doit effectuer des monitorings, on doit suivre ces populations pour voir si en effet, elles peuvent vraiment vivre dans le milieu naturel. Et souvent, il y a pas mal de greenwashing. On dit : "Oh génial, on va réintroduire telle bestiole". Et puis on relâche les animaux et puis plus rien parce qu’il n’y a plus de budget pour suivre ces populations. Une de mes étudiantes a fait une analyse globale sur tous les projets de réintroduction qui ont été faits au cours des 20 dernières années, et on se rend compte que 90% des projets de réintroduction n’ont pas été suivis. Mais à côté de ça, on a fait beaucoup de pub, on a fait beaucoup de greenwashing".
Pour l’expert, la meilleure façon pour qu’une espèce puisse vivre dans son habitat naturel est de financer des programmes sur le terrain pour préserver ces espèces dans leur milieu naturel.
Source (avec photos): https://www.rtbf.be/article/les-naissances-d-animaux-rares-dans-les-zoos-bonne-ou-mauvaise-chose-11585617
Nous avons déjà eu ce débat à maintes reprises, il y a quelques années. C'est la première fois (à titre personnel) que je vois ces interrogations dans la presse généraliste. Changement d'époque...
Je n'ai pas retrouvé le (les) topics concernés, mais ça permet aux nouveaux du forum de se lancer dans ce débat.